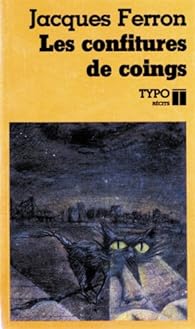Terminé la lecture du second livre acheté cet été à Montréal, Les Confitures de coings, de Jacques Ferron. Le premier, Les Vendeurs du Temple, d’Yves Thériault, était un roman très classique dans sa forme, de peu d’envergure d’une manière générale. Celui-ci est plus intéressant, en particulier parce que l’auteur y adjoint un conséquent appendice autobiographique qui révèle tout un sous-texte très politique (du moins pour quelqu’un comme moi peu au fait des réalités du Québec). L’un comme l’autre d’ailleurs sont très ancrés dans le pays, et pas seulement de façon géographique ; ils traitent de questions qui lui sont spécifiques, et réfutent en leur substance même l’éventuelle idée que la littérature québécoise serait une province (fût-elle « belle ») de la littérature française. C’est évidemment ce qui en fait, pour une part l’intérêt, l’étrangeté.
Je ne me rendais pas compte, du moins avant d’y aller cet été, de la profonde différence de genèse entre le Québec d’aujourd’hui et la France. C’est toute la structure de la société qui est restée différente jusqu’à très récemment. Et c’est passionnant de voir comment elle a permis de résister à « l’Anglais », mais a tout autant été un instrument de domination de la majorité du peuple – des paysans dispersés dans des communautés peu urbanisées ; la féodalité, maintenue dans les faits jusqu’au milieu du siècle (m’a appris Paule, la mère d’Hélène, lorsque nous avons fait le trajet jusqu’au moulin où avait lieu la fête du mariage) ; avec son système archaïque d’impôts exténuants, et l’Église, qui devait exercer sur les consciences un poids qu’on a du mal à imaginer. Elle m’a raconté que quand sa grand-mère a estimé qu’elle avait eu assez d’enfants, plutôt que de prendre simplement des mesures pour ne plus en avoir, est allée voir le curé du village pour lui demander si elle avait le droit d’arrêter d’en faire ! Ce à quoi le curé, selon le principe « Croissez et multipliez » lui a répondu que ce serait un péché grave. Alors elle a continué… Elle en avait pourtant déjà un nombre faramineux, douze ou treize ; mais toutes les familles qui le pouvaient biologiquement étaient nombreuses — et l’adjectif voulait dire quelque chose ! Il faut se représenter ce que ça signifiait de temps enceinte pour une femme, un véritable esclavage. Bien plus encore qu’à la fin du siècle dernier en France, le pays devait baigner dans une effroyable bondieuserie ; ce n’est partout qu’immenses monastères, d’ailleurs. Et pour ce qui est de la position sociale des religieux, il n’y a qu’à voir les presbytères dans les villages (en France les curés de petites paroisses n’étaient pas forcément très bien lotis). C’est facile, c’est la maison juste à côté de l’église, bâtie en général dans le même style : ce sont aussi, de loin, les plus imposantes. Des baraques énormes, prétentieuses, clinquantes souvent, avec péristyles, nombreuses portes et fenêtres, plusieurs étages — pour un type seul, qui plus est. Enfin peut-être avec sa bonne.