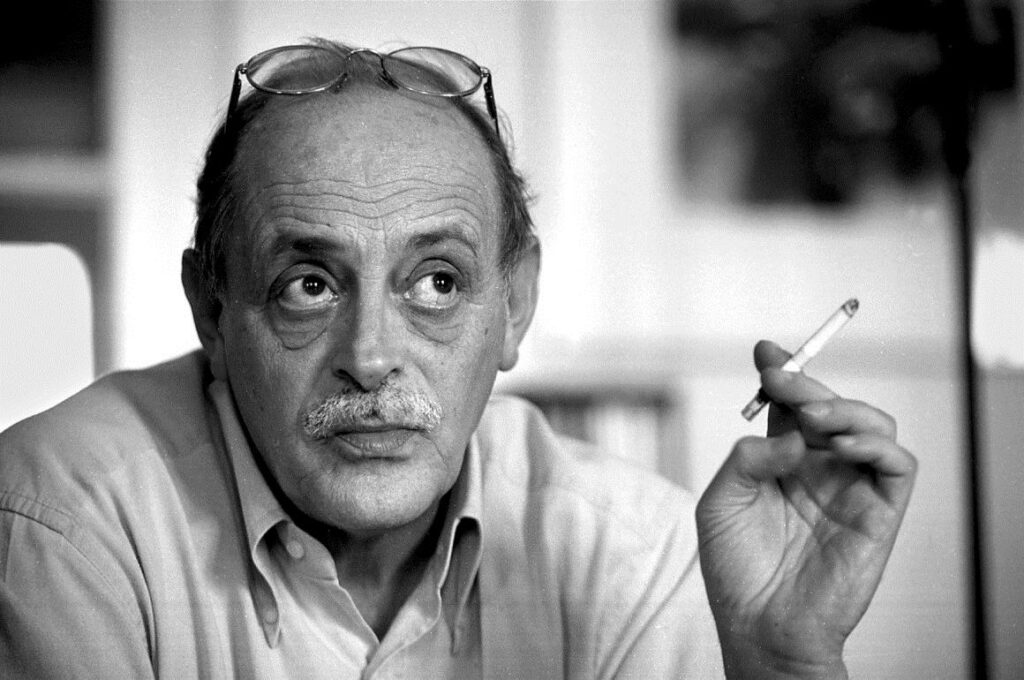Michel Cloup avait acheté une vieille maison, une sorte de maison de village campagnard morbihanais, en pierre, et voilà qu’un incendie s’y déclare brusquement. On a beau faire ce qu’on peut, l’incendie s’étend, et il ne reste plus de la maison que le mur mitoyen noir de suie, celui le long duquel courait le conduit de la cheminée ; plus rien d’autre ne reste debout. Peut-être le feu s’est-il déclaré justement dans la cheminée, par moment on aurait pu être à l’intérieur d’un four à pain, au plafond voûté et très bas. Le plus étonnant est qu’il nous a fallu ensuite manger les restes de la maison, qui était en même temps qu’une maison de pierre un plat copieux à base de riz, l’important étant alors de ne pas tomber sur les morceaux qui avaient le plus brûlé lors de la cuisson, que leur âcreté rendait impossibles à ingérer. Voilà parmi d’autres que je n’ai pas su me rappeler, un épisode de la nuit passée ; j’aurais bien aimé m’en rappeler plus, parce que tout était plus ou moins lié, mais il ne me reste que des images trop floues pour essayer même d’en donner une idée. Je ne me suis réveillé que tard, il était pas loin de onze heures, mais j’avais besoin de ce sommeil pour effacer la fièvre que j’avais encore hier soir (cette année, je n’aurai pas cessé d’être vaguement malade[1]), et la fatigue de la soirée chez Joris, occupée toute entière à produire un misérable texte de présentation pour son film. J’ai traîné encore au lit, pour finir La Tête perdue de Damasceno Monteiro, un roman d’Antonio Tabucchi médiocre, que la vendeuse de Coiffard m’avait pourtant chaudement recommandé. Faisait-elle alors un simple argument commercial à un type qu’elle ne jugeait pas particulièrement féru de ce domaine, ou a-t-elle mauvais goût en matière de livres ? Sa jolie mine m’avait porté à lui faire confiance (blonde aux yeux bleus lumineux, les cheveux coupés courts), mais ce roman ne risque pas de détrôner Pereira prétend, dont je lui ai expliqué que c’était pour le moment mon préféré de cet auteur (je n’arrivais d’ailleurs pas à me rappeler son titre, il a fallu que je résume l’histoire pour voir de quoi il s’agissait). On peut d’ailleurs se demander s’il ne constitue pas une erreur dans sa production, tant La Tête perdue… lui est inférieur : une banale histoire policière, construite et racontée à la va-comme-je-te-pousse, sans que rien soit ménagé pour développer l’intérêt, des personnages épais comme un papier à cigarette, des discours verbeux, qui se voudraient dénonciation de la torture mais ne vont pas au-delà d’une dissertation de collège ; le tout mal écrit, convenu au possible, parsemé d’indication dans le genre d’un guide touristique bas de gamme qui aurait pour sujet la ville de Porto. Le style de livre qui sera illisible dans vingt ans, prêt-à-lire vite fabriqué, vite jeté. Pereira prétend manque sans doute un peu de corps pour être un véritable chef d’œuvre, mais celui-là est tellement mauvais qu’on peine à croire qu’il a le même auteur.
[1] Ça m’a pris dès dimanche après-midi, lorsque nous essayions de jouer avec Chepe et Broerec, je n’étais pas vraiment réceptif, j’avais mal à la tête, puis chez Ermold, alors que je l’aidais à préparer des cartons de livres pour son déménagement, et ça ne m’a pas quitté ; j’ai dû prendre froid à Oxymore.